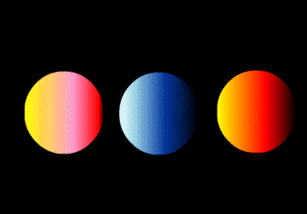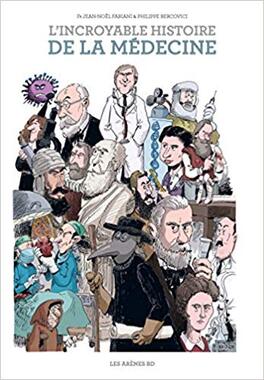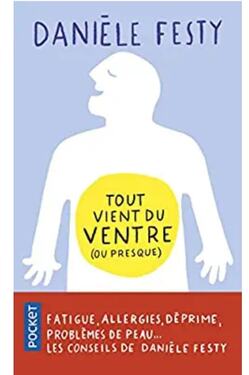-
Veaux, vaches, cochons : 10 raisons d’en finir avec l’élevage intensif

Il pollue, fait souffrir les bêtes et les éleveurs, réduit la biodiversité, n'assure pas la traçabilité… L'élevage industriel n'est plus viable. Voici pourquoi.
En vacances ou au boulot, vous n’avez pas pu passer à côté de l’une des infos de l’été : la crise de l’élevage. Ou plutôt les crises, bovine, porcine et laitière. Depuis plusieurs semaines, les éleveurs sont en colère, notamment contre des prix trop bas. D’un côté, le gouvernement leur promet des subventions, des aides, des plans d’urgence. De l’autre, les gros industriels boycottent et ne veulent plus acheter les animaux (le marché vient de reprendre doucement cette semaine, mais le dialogue demeure compliqué). Le tout, sans que personne – notamment les politiques – ne remette en question ce modèle, celui de l’élevage industriel, majoritaire aujourd’hui en France. Ainsi, 68% des poules pondeuses sont élevées en cage. Quant aux cochons, selon Inaporc, l’interprofession nationale porcine, 95% sont élevés en batterie, sur caillebotis dans des bâtiments fermés. Et pourtant… ironiquement, quasiment le même pourcentage de Français – 90% – se déclarent contre l’élevage industriel, selon un sondage OpinionWay réalisé en 2013. Voilà donc pourquoi, en dix points – et à grands renforts de nos propres archives ! –, il faut en finir avec l’élevage industriel.
 Parce que ça pollue
Parce que ça pollue
en émettant des gaz à effet de serre…
Selon un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’élevage compte pour 14,5% de nos émissions de gaz à effet de serre (GES) (7,1 gigatonnes d’équivalent CO2 par an), c’est-à-dire plus que l’ensemble du secteur des transports. Les principales sources de pollution ? La production et la transformation de fourrage (45% du total des émissions), la digestion des bovins (39%) et la décomposition du fumier (10%) Voir ici notre infographie sur le sujet.
… mais aussi à cause de l’impact sur les sols et l’eau
Les bâtiments hors-sol produisent des tonnes d’excréments. Et si le lisier produit plus de nitrates que la terre et les plantes ne peuvent en absorber, alors l’excédent s’infiltre dans les sols et s’écoule dans les rivières. En Bretagne, par exemple, selon les chiffres du ministère du Développement durable, deux tiers de l’azote épandu est issu des déjections des vaches (à 57%), des porcs (à 31%) et des volailles (à 12%). L’eau chargée en nitrates finit son voyage dans la mer et les fameuses algues vertes naissent, stimulées par cet excédent. Ces dernières peuvent, elles, en plus d’entraîner des fortes nuisances olfactives, représenter un risque pour l’homme. Et le dernier bilan du Commissariat général au développement durable n’est pas rassurant : loin de diminuer, en 2012, les végétaux toxiques ont colonisé l’ensemble du littoral français.
Les émissions d’ammoniac – gaz irritant pouvant provoquer certaines maladies (asthme, bronchites chroniques) chez les éleveurs et les animaux – sont quant à elles à 95% d’origine agricole, dont 80% proviennent de l’élevage, selon un rapport de l’Institut national de la recherche agronomique (Inra). Parce que ce n’est pas bon
Parce que ce n’est pas bon
au goût…
En avril dernier, le restaurateur et amoureux de la bonne bouffe Xavier Denamur évoquait« l’exemple du poulet », « édifiant », dans notre dossier sur « Le goût assassiné ». « Comment voulez-vous qu’une bête programmée pour grossir en quarante jours, remplie de flotte, qui devient obèse, malade et incapable de tenir sur ses pattes si on ne l’abat pas à temps, ait le même goût qu’un poulet qui aura galopé cent vingt jours ? », s’interrogeait-il. Pour rappel, un poulet de batterie est abattu à 35/40 jours, tandis qu’un bio ou Label rouge doit l’être à minimum 81 jours. La démonstration est la même pour le porc et le bœuf, dont le goût est bien meilleur quand l’animal a galopé dans de vertes prairies.
… et pour la santé
L’an passé, l’association UFC-Que choisir a fait passer au labo 100 échantillons de poulet. Plus d’un quart en sont sortis « contaminés ». Et les deux tiers de ceux-là l’étaient par des bactéries résistantes aux antibiotiques. A force de gaver le poulet de batterie d’antibios pour qu’il survive à la surpopulation de son hangar et aux épidémies, des souches mutantes de bactéries apparaissent, insensibles aux médicaments… conçus à l’origine contre elles ! Parce que les bêtes souffrent…
Parce que les bêtes souffrent…
Cette récente crise du porc a – au moins – permis aux téléspectateurs de (re)voir, en images, ce qu’est un élevage industriel. Des porcs entassés (un animal de 110 kg dispose d’un mètre carré pour vivre), qui ne verront jamais la lumière du jour, des poules qui ne peuvent pas déployer leurs ailes (en cages, elles ont le droit, chacune, à un espace à peine supérieur à une feuille A4, soit plus de 13 poules par mètre carré), des veaux qui sont arrachés de leur mère pour produire du lait… On vous passe les détails et on vous conseille cette lecture passionnante sur les conditions de travail dans un élevage intensif de porcs ou le film pastiche Meatrix.
… et les éleveurs aussi
C’est certainement la sociologue Jocelyne Porcher, spécialisée dans la relation entre l’éleveur et l’animal – et qui a également été éleveuse, puis salariée dans une production porcine – qui parle le mieux de cette question. En 2014, voici ce qu’elle disait à Terra eco : « Quand on lit les textes agricoles, on se rend compte que la rupture des mentalités a lieu au XIXe siècle, quand le capitalisme industriel invite à considérer l’animal comme une ressource comme une autre qui doit assurer de la productivité et va exclure la relation d’affectivité entre l’éleveur et l’animal. » Selon elle, les méthodes de travail sont désormais « taylorisées » et l’urgence, « permanente ». Même constat de la philosophe Corine Pelluchon, à qui l’on consacrait un grand entretien il y a quelques semaines : « Les éleveurs aussi sont victimes de l’élevage industriel. Ils ne sont pas heureux. Ils doivent se plier à des normes extérieures, les zootechniciens leur disant quand réformer un cochon(le destiner à l’abattage, ndlr), par exemple. On ne s’appuie plus sur leur bon sens. L’éleveur traditionnel savait quand son animal allait bien ou pas. Au nom de la course au profit, on a transformé l’élevage en production industrielle et détruit le sens de cette activité. Condition animale, organisation du travail et justice sociale sont étroitement liées. » Parce qu’il y a un problème avec les prix
Parce qu’il y a un problème avec les prix
« Les Français ne mesurent pas les efforts fournis pour répondre à des attentes paradoxales, comme manger mieux et toujours moins cher », s’exclamait dans nos colonnes, en 2013, Christiane Lambert, vice-présidente de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Manger mieux, mais à prix bas, semblerait donc être le souhait du consommateur. Et peut-être surtout des distributeurs. Il n’y a d’ailleurs qu’à faire un tour de leurs slogans pour n’en pas douter :« Chez E.Leclerc, vous savez que vous achetez moins cher » ; « Intermarché, tous unis contre la vie chère » ; « Les prix bas, c’est Géant »… Mais qu’est-ce qu’un prix bas ? Et qu’est-ce qu’un prix juste (pour l’acheteur, mais aussi, et surtout, pour l’éleveur) ? Et comment le consommateur peut-il savoir où va aller son argent quand il achète de la viande ou du lait ? Comme le rappellent nos confrères de Rue89, depuis 2010, il existe un Observatoire de la formation des prix et des marges, publiant chaque année un rapport sur le sujet. Ainsi, pour le jambon cuit – l’un des produits les plus vendus en charcuterie –, le prix moyen du kilo au détail est passé, de 2013 à 2014, de 10,93 euros à 11,05 euros en grandes et moyennes surfaces (GMS). En 2013, 38% (4,17 euros) du prix déboursé par le consommateur revenait à la grande distribution et 33,8% (3,70 euros) à l’éleveur. En 2014, respectivement, cette part passait à 39% (4,32 euros) et 31,3% (3,46 euros). Le reste est réparti entre les industries de charcuterie-salaison et abattage-découpe.
Pour le poulet, la hausse des marges des distributeurs est encore plus importante. Si le prix en rayon n’a pas augmenté entre 2013 et 2014 (4,26 euros en moyenne le kilo pour un poulet standard), la marge des GMS était de 39,6% en 2013 – 33,8% pour l’éleveur – et de 41,7% – 31,4% pour l’éleveur – en 2014.
 Parce que la traçabilité est floue
Parce que la traçabilité est floue
Avez-vous déjà cherché la provenance du porc que vous allez engloutir sur un paquet de jambon ? L’avez-vous trouvée ? Si vous avez opté pour les marques Fleury Michon, Madrange, Aoste ou Herta, non, à coup sûr ! Un tiers des jambons cuits et deux- tiers des jambons secs présents sur le marché français ne portent aucune de ces indications. Aoste, par exemple, se fournit en porc en France, mais aussi en Espagne, en Allemagne ou aux Pays-Bas, en fonction de l’état du marché.« Cela dépend de ce qui est disponible à l’instant T de l’approvisionnement », nous expliquait la marque en février dernier. Dans ces circonstances, impossible d’afficher la provenance sur le paquet, « d’autant que, pour certains produits, des pièces de nationalités différentes peuvent être mélangées ». Parce que la biodiversité en souffre
Parce que la biodiversité en souffre
Comme le soulignait « L’Atlas de la viande » en 2014, « la surfertilisation nuit aux plantes et aux animaux. Les nitrates présents dans les eaux souterraines peuvent produire des “zones mortes”, privées d’oxygène, dans les eaux côtières ». Ce rapport, publié par la Fondation Heinrich Böll et les Amis de la Terre, rappelle également qu’avec l’élevage industriel, la diversité génétique part aux oubliettes. Dans le monde, quatre compagnies se partagent 97% de la recherche sur le poulet et 75% de la recherche sur les bovins et le porc. « Conséquence : la diversité génétique se réduit drastiquement, oubliant la majorité des 8 000 espèces domestiquées actuellement recensées. Par exemple, la race de vache Holstein couvre 83% du marché mondial du lait. Quant aux porcs, trois races se partagent les trois quarts du marché. » Parce que ça nuit à l’emploi
Parce que ça nuit à l’emploi
Depuis 2013, agrandir une porcherie est devenu un jeu d’enfants. Un décret permet de créer des usines de 2 000 cochons sans demander d’autorisation spéciale. De la ferme des 1 000 vaches à celle des 1 500 taurillons, les méga-exploitations se multiplient (Voir ici notre carte). Dans le même temps, comme le rappelait Libération, le nombre d’éleveurs de vaches laitières en France est passé 162 000 à 67 000 entre 1993 et 2013 (-58%). Sur la même période, la production de lait, elle, progressait de 5%. Laurent Pinatel, de la Confédération paysanne, s’alarmait dans nos colonnes des conséquences sur l’emploi des méga-fermes : « Chaque fois qu’une ferme grossit, on perd de l’emploi. 20 fermes de 50 vaches, c’est plus de 40 emplois. Une ferme de 1 000 vaches, c’est quatre fois moins et une qualité de travail dégradée. »
A lire aussi sur Terraeco.net (parce qu’il y a des solutions) : « Du conventionnel au bio, la transition d’un agriculteur (épisode 1) : une histoire de famille »
« Du conventionnel au bio, la transition d’un agriculteur (épisode 1) : une histoire de famille »  « Du conventionnel au bio, la transition d’un agriculteur (épisode 2) : une histoire de gros sous »
« Du conventionnel au bio, la transition d’un agriculteur (épisode 2) : une histoire de gros sous »  Les visages de l’agriculture de demain
Les visages de l’agriculture de demain  Agriculture : une ultra moderne servitude
Agriculture : une ultra moderne servitudehttp://www.terraeco.net/Veaux-vaches-cochons-10-raisons-d,61425.html
 Tags : 2014, l’elevage, prix, industriel, poulet
Tags : 2014, l’elevage, prix, industriel, poulet
-
Commentaires
Mon diabète, mon meilleur ami !








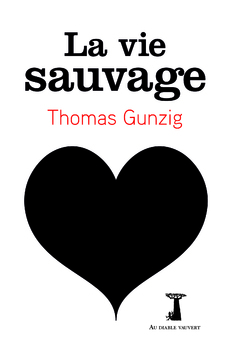


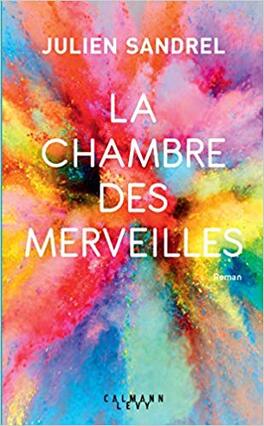




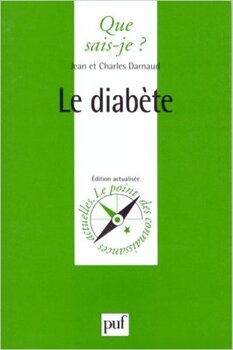


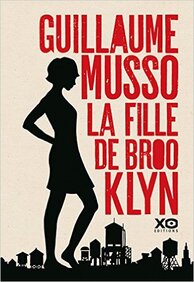


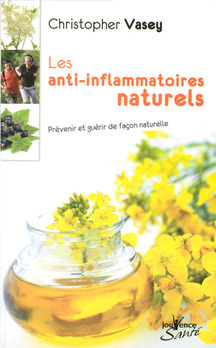
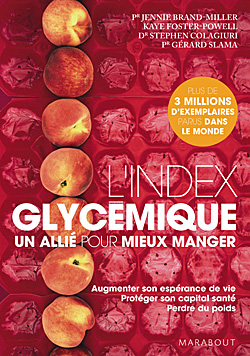
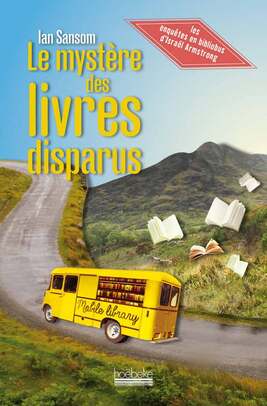
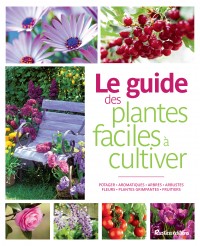













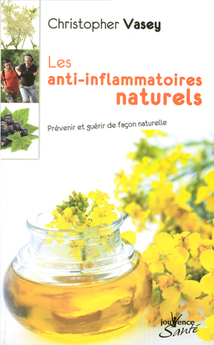

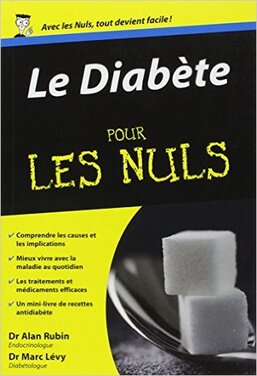



 www.dinnosante.fr/fre/33/aller-plus-loin/glucozor
www.dinnosante.fr/fre/33/aller-plus-loin/glucozor

































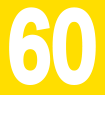







 www.pourquoidocteur.fr
www.pourquoidocteur.fr
 www.centreantipoisons.be/
www.centreantipoisons.be/